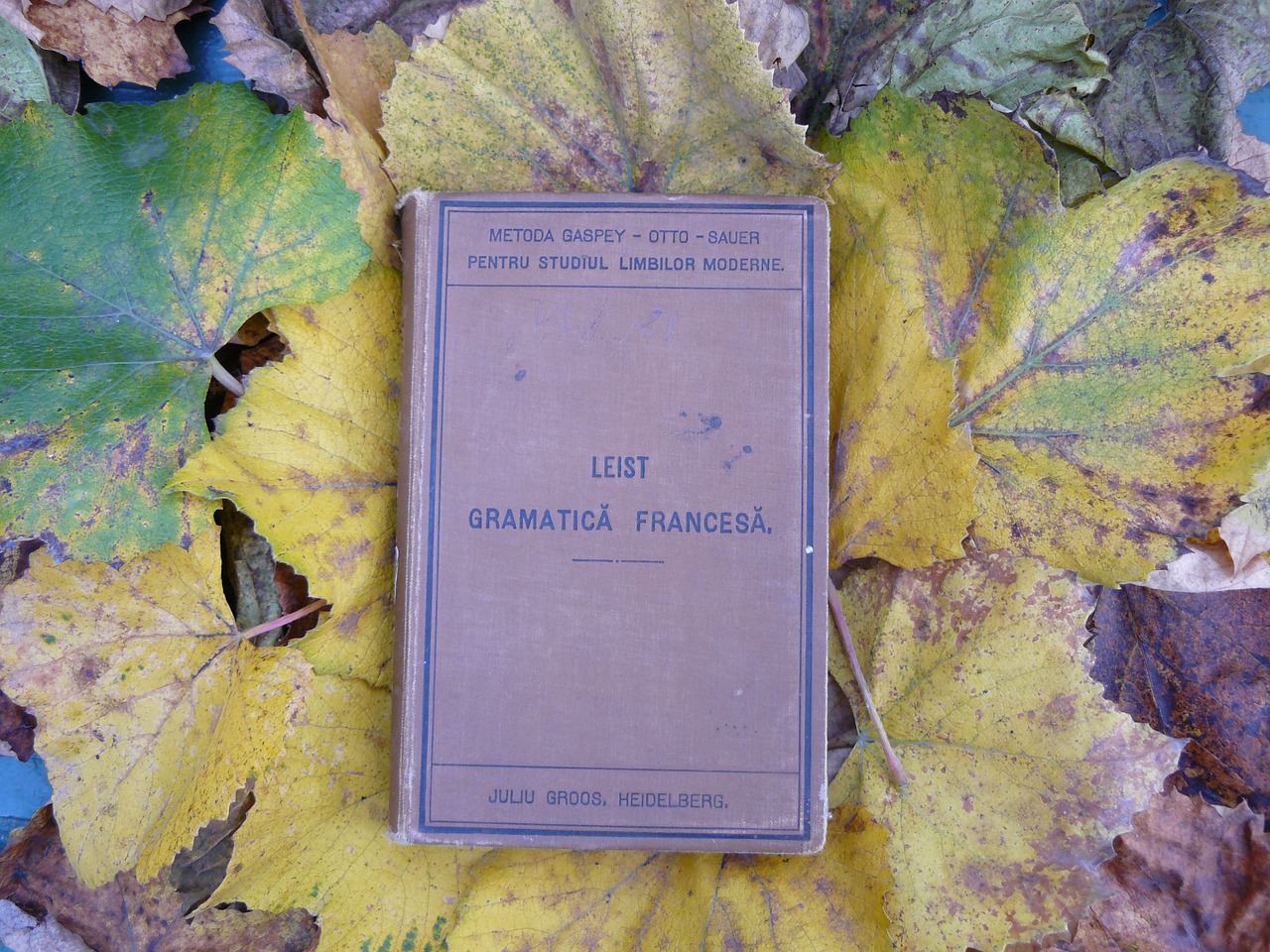Publié le 14 septembre 2021
par Violaine Carry
L’illusion d’une grammaire « au service de »
Depuis les années 1970 et jusqu’à aujourd’hui, les pédagogies réduisent la grammaire à un outil au seul service de la lecture et de l’écriture. On pourrait se dire que ce décloisonnement est plutôt bienvenu ; il réintroduit du sens dans une étude de la langue qui était vidée de sa substance, embourbée dans son héritage bourgeois et napoléonien.
D’où un scénario pédagogique qui reste la référence de nos jours : un temps d’observation de phrases issues de la littérature ou du langage courant, qui débouche, par phénomène de généralisation, sur un temps de cours, puis d’appropriation des règles par des exercices, qui doivent à leur tour aboutir à l’élaboration d’un texte qui exploite ce fait de langue et justifie le cours de grammaire, celui-ci ayant forcément amélioré les compétences rédactionnelles des élèves. Voilà qui est formidable de cohérence pédagogique… mais ne résiste pas à une analyse plus poussée.
Tout d’abord, cela suppose une relation de causalité entre métagognition (dans la phase d’observation des faits de langue) et amélioration du geste d’écriture. Il y en a une, bien sûr, mais extrêmement ténue : nombre d’élèves n’attendent pas d’avoir un cours sur la forme emphatique ou la focalisation interne pour les employer dans leurs écrits ; et inversement, comprendre le fonctionnement de la gradation ou de la phrase complexe ne prémunit pas contre les maladresses de construction. En clair, en termes d’efficacité, la métacognition est battue à plate couture par l’usage. Comment l’expliquer ?
Procédural vs analytique
La lecture et l’écriture ne mobilisent pas tout à fait le même système de pensée que l’étude de la langue. Elles relèvent en effet en grande partie d’un apprentissage procédural, c’est-à dire de l’automatisation d’un certain nombre d’opérations, de procédures. La lecture ne se résume pas au déchiffrement de séquences de lettres, ni l’écriture au geste graphique. Pour lire ou écrire, il faut aussi maîtriser le code qui régit la langue, sa grammaire. Seulement, ce code, on ne l’acquiert pas à l’école ; sans quoi aucun enfant ne pourrait s’exprimer autrement que par de simples mots avant ses premiers cours de grammaire française. La langue, avec son système lexical et grammatical, se transmet d’abord par la parole et l’expérience qu’on en a, et ce depuis notre existence intra-utérine. Les parents et les proches apportent donc les premiers à l’enfant la matière langagière qui lui servira à bâtir sa grammaire.
Car le bébé possède un cerveau incroyablement puissant et flexible, qui passe son temps à calculer les statistiques à partir de ses multiples expériences : chaque nouveau contact avec la langue est intégré et comparé avec les précédents, et sert de base à l’élaboration de définitions et de règles, qui seront confirmées ou modulées par les contacts ultérieurs. Ainsi, à force d’entendre le mot « chaise » associé à toute sorte d’objet, le bébé finit par en dégager les traits communs et sémantiser le concept « chaise » ; de la même manière, par superposition d’épisodes (c’est-à-dire d’expériences contextualisées), il comprend que certains mots (par exemple, les verbes transitifs) sont toujours suivis d’autres (les compléments) et acquiert alors, par mimétisme et habitude, les rudiments de la syntaxe de sa langue. Ainsi, pour l’enfant, c’est bien l’usage qui est le maître et plus exactement l’usage auquel il est confronté – plutôt que l’usage « du plus grand nombre » de personnes. Ce fonctionnement, qui est par ailleurs valable chez l’adulte, est résumé sous l’expression « cerveau bayésien » ou « cerveau statisticien » ; Alain Lieury, neuroscientifique spécialiste de l’éducation, évoque, lui, un apprentissage multi-épisodique. Ce phénomène explique les disparités énormes en termes de développement du langage à l’entrée en maternelle : tout dépend du milieu, plus socio professionnel qu’économique d’ailleurs, dans lequel chaque enfant est élevé.
Cette grammaire personnelle et plus ou moins riche n’est pas conscientisée ; elle est enregistrée au niveau de la mémoire dite procédurale cognitive, qui permet d’automatiser des figures de pensée, et ainsi les tours syntaxiques propres à une langue. On la voit se manifester quand un élève justifie son emploi de l’imparfait plutôt que du passé simple par un « parce que ça sonne mieux », ou quand, sans identifier une erreur de syntaxe, on a tout de suite perçu que « ça ne se disait pas ». Attention : cette maîtrise de la grammaire est loin d’être intuitive ; elle est le fruit d’une expertise qui nécessite d’engranger des millions et des millions de rencontres avec la langue, à l’oral comme à l’écrit.
Ce n’est qu’en entrant à l’école que l’enfant va devoir harmoniser sa grammaire avec la grammaire du français. C’est une manière de s’assurer que les individus font société, à travers le partage d’une même langue. Selon l’environnement extra-scolaire, cette harmonisation sera plus ou moins facile, demandera plus ou moins d’efforts. Et c’est sans compter les situations où l’écart est tellement important que l’élève se trouve tiraillé entre deux usus parfois inconciliables.
Que sont alors quelques séances de grammaire face à des milliers d’heures d’immersion dans la langue ? Bien peu de chose. Si le but est d’améliorer les compétences langagières des élèves, mieux vaut les faire lire le plus possible, puis écrire et échanger avec eux en veillant à respecter un niveau de langue courant voire soutenu. Le cours d’étude de la langue, lui, développe d’autres compétences.
De l’utilité du cours de grammaire au XXIe siècle
Le cours de grammaire a pour objet la langue elle-même. Cette posture métalinguistique est cognitivement très exigeante puisqu’elle demande à l’observateur une flexibilité mentale qui lui permette de faire des allers-retours incessants entre le signifié et le signifiant et ce, à différents niveaux (traditionnellement le mot, la proposition, la phrase complexe, le texte). Cette démarche requiert une méthode rigoureuse et de la patience, comme toute approche scientifique, mais aussi de la créativité pour inventer des outils d’analyse et des concepts, et même une pensée divergente afin de s’affranchir des classements et principes précédents pour en proposer de nouveaux. Extrêmement coûteuse en énergie, cette pensée analytique apporte également de nombreux bénéfices à celui ou celle qui la pratique régulièrement. Tout d’abord, elle permet à l’élève de s’exercer à la métacognition. Même la syntaxe la plus basique, la plus « neutre », révèle un tour de pensée, un réseau de relations particulières entre les éléments de la phrase, ne serait-ce qu’imposée par la grammaire de la langue. Il en résulte qu’étudier le fonctionnement de la langue revient à observer sa propre pensée. Aussi est-il crucial que les élèves n’apprennent pas simplement à reconnaître un COD, mais qu’ils comprennent ce qu’est un COD et quelle relation il entretient avec le verbe et le sujet et ce que cela révèle : ainsi seront-ils peut-être plus sensibles à la vision du monde que traduisent ces situations littéraires, où tel personnage féminin n’apparaît jamais qu’en fonction d’objet, direct ou indirect…
Aussi le cours de grammaire me semble-t-il particulièrement pertinent quand il s’appuie sur la comparaison ; comparaisons de tours anciens et modernes, de constructions populaires et soutenues, d’idiomes français et étrangers. Pourquoi s’exprime-t- on ainsi ? Pourquoi l’usage privilégie-t-il telle ou telle formulation ? Qu’est-ce que cela révèle de notre état d’esprit ? de celui de nos voisins ? Et quel effet cela produit-il si on adopte telle construction plutôt que telle autre ? si on bouleverse l’ordre canonique des mots ? Éveiller les élèves sur les possibles de la langue, les leur faire toucher du doigt et s’amuser de ses contraintes, mais aussi leur faire réaliser que la langue est vivante, qu’elle évolue et se renouvelle sans cesse, par son passage dans les campagnes autant que les banlieues et les centre-ville, ses métissages avec d’autres langues plus ou moins lointaines : voilà ce qui pourrait être au cœur du cours de langue. Enfin, cette pratique métacognitive est une école de la rigueur. Des observations émergent des hypothèses qu’il s’agit ensuite d’éprouver – par les textes bien sûr, mais aussi les expériences personnelles des élèves avec le langage. Il faut d’abord s’assurer que les catégories qui permettent de penser la grammaire sont bien assimilés au moyen d’exemples et d’exercices. Mais on ne doit pas éluder les cas-limites, ces situations-problèmes qui donnent l’occasion aux élèves de développer leurs capacités analytiques et critiques. Comme en sciences, un des objectifs est de s’approprier les choses, pour être moins passif face au langage, moins naïf aussi, moins manipulable à ses effets de manche, plus lucide à tous les biais cognitifs qu’il charrie.
Un exemple très simple et d’actualité pourrait être, à l’occasion d’un cours sur les accords, de lancer le débat sur l’orthographe inclusive : d’où vient cette demande ? Pourquoi ? La prééminence du masculin sur le féminin vous semble-t-elle un réel instrument de domination masculine ? Qu’en était-il avant ? etc. Plus récemment, on pourrait interroger les élèves sur cet étrange phénomène du changement de genre du – pardon de la – covid…
Pour un enseignement de la grammaire comme une matière à part entière
On le voit, donc, la grammaire est moins un outil au service de la lecture et de l’écriture – ou bien il brille par son inefficacité – qu’une discipline qui forme les esprits à la raison et à la critique. Aussi, un décloisonnement trop systématique risque de s’avérer contre-productif, car il repose sur une illusion.
En revanche, exposer clairement la fonction de la grammaire, la réhabiliter comme matière à part entière, introduction à la métacognition et à la philosophie, pourrait en dépoussiérer l’image figée et réengager les élèves dans sa pratique.
Il est urgent de (re)former les professeurs à cette pratique, finalement idéologique (au sens de Condillac), de la grammaire, en premier lieu via l’enseignement de l’histoire de la grammaire, et pas seulement de la grammaire historique. Cela pose également la question de la nomenclature qui doit être justifiée auprès des élèves. On le constate lors des ajustements dans la terminologie. Par exemple, cet été 2020, l’« exclamative » a été exclue des types de phrase, désormais classée dans les « formes » de phrases, au côté des formes affirmative et négative. Cela peut se justifier, puisque le types de phrases s’excluent mutuellement (une phrase ne peut être interrogative et déclarative en même temps) alors que l’exclamation peut se conjuguer à plusieurs types de phrases. Déconstruire des représentations antérieures, comme celle qui faisait de l’exclamation un type de phrase, impose un travail explicatif assez complexe.
Il est un signe que la grammaire, en soi, revient sur le devant de la scène : la question de langue à l’oral du bac de français. Si il évolue vers l’expression d’une véritable réflexion sur la langue et non un catalogue stérile des différentes formes de subordonnées ou autres, l’enseignement de la grammaire au lycée, et par répercussion au collège, devrait retrouver tout son sens.
NRP – Novembre 2020
Consultez d’autres articles sur les neurosciences